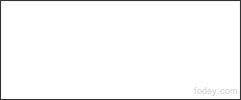0138-/-ACTUALITÉS Du Vendredi 18 Mai 2018
*******
Vendredi 18 Mai 2018
|
|
الجمعة 18 ماي 2018 م
الجمعة 02 رمضان 1439 ه
الجمعة 18 ماي 2018 م
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prévisions météo Algérie pour Vendredi 18 Mai 2018
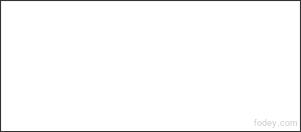 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
أحوال الطقس في الجزائر ليو الجمعة 18 ماي 2018 م
|
|
|
|
|
|
 |
++
|
|
|
+++++++++++++++++++++++++
 |
| |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 © El Watan
© El Watan
Ramadhan et travail : A la recherche du temps perdu
le 18.05.18 | 12h00

Même décor pour les Algériens pendant le Ramadhan. Une journée qui se résume en un peu de travail, beaucoup de sommeil. Difficile pour certaines entreprises de cerner et mieux contrôler les horaires de travail pourtant officiellement allégés pour l’occasion.
Chaque année, la Fonction publique réduit le volume horaire qui est passe de 8 heures à 7 heures de travail. Mais cela ne concerne que les secteurs faisant partie de la Fonction publique. Pour les autres institutions de service public et le secteur privé, l’organisation se fait autrement : certains suivent et d’autres «s’organisent» par brigade ou autre.
Dans certaines administrations, les femmes sont libérées plus tôt que les hommes. Ou elles choisissent de travailler la matinée et de se libérer l’après-midi. Officiellement, la plupart des Algériens doivent travailler 7 heures, mais en réalité, ils partent au travail mais pas pour travailler.
«Ramadhan c’est comme le théâtre en deux actes : le matin on dort au bureau et l’après-midi on parle du menu et de ce qu’on peut faire pendant la soirée.» Mohamed, 31 ans, chargé de communication dans une entreprise publique, nous résume tout. Une journée de Ramadhan vue par ceux et celles qui sont convaincus que jeûne ne rime pas avec travail. Plus le temps passe, plus les envies augmentent.
Et il ne s’agit pas seulement de la faim, mais aussi du sommeil. Pour Samir, 33 ans, «s’il y a une pointeuse tu dors au bureau et s’il n’y en a pas tu esquives pour dormir chez toi». Achour, 39 ans, manager dans une entreprise privée, confie : «Un choix s’impose entre sécher les dernières heures ou rester se morfondre au bureau.» C’est normal si les habitudes changent le rythme va avec : paresse, fatigue, faim…
Explications
Tout cela est sociologiquement expliqué par Bouabdallah Kacemi, sociologue, chercheur CRASC : la fatigue résulte du manque de sommeil, tout comme la difficulté de concentration. «La question du sommeil est un phénomène récurent. Les algériens par tradition veillent et rejoignent leurs lieux de travail fatigués», indique le sociologue.
«Dans les sociétés occidentales, on ne trouve pas cela. C’est dans les sociétés arabes que ce phénomène existe. Il faut adapter une discipline et le problème est le manque de sommeil. On veille, alors on part au travail fatigué, ce qui provoque fatigue, nerfs, paresse...
Ces facteurs nous rendent moins créatifs.» Tout le monde garde l’image des personnes qui s’installent pendant des après-midi entières dans les mosquées bien fraiches. Une exception est faite pour certains domaines comme les travaux publics, les bases pétrolières ou d’autres secteurs économiques où les ouvriers sont sommés de respecter rigoureusement leurs horaires de travail.
Pénible
Pour Mokrane, 35 ans, cadre dans une entreprise pétrolière nationale, «ceux qui travaillent dans les administrations peuvent sortir plus tôt. Mais ceux qui sont sur les chantiers, il leur est impossible de s’arrêter. On travaille par équipe et la rupture du jeûne se fait en trente minutes puis on reprend le travail. Ce qui est le plus fatigant c’est le chantier : chaleur insupportable, déshydratation, les lèvres sèches jusqu’à avoir mal».
Mais d’autres profitent de Ramadhan pour lever le pied. Des congés sont même programmés. Narimane, 27 ans, employée dans une entreprise privée : «J’ai fait l’expérience de travailler la journée l’année dernière, déjà que j’habite loin de mon lieu de travail, je pensais qu’à rentrer et au moyen le plus rapide pour le faire.
Cette année j’ai demandé un congé pour être plus tranquille»… Pour Kamel Bouguessa, sociologue, le Ramadhan est un période de «végétation». Autrement dit, ces «paresseux» sont aussi malins. Le sociologue argumente sa théorie par le fait que les travailleurs «attendent que tout vienne d’en haut pour ne pas se remettre en cause ou assumer des faits.. C’est la passivité qui s’installe».
Le sociologue remet en cause «l’organisation au travail». «Un supérieur hiérarchique doit superviser. Dans le cas contraire, il y a un laisser- aller de la part des supérieurs», dit-il encore. Mais au moins dans un domaine, on ne fait pas l’exception dans le monde qui nous ressemble. En Tunisie, au Maroc ou encore en Egypte, le rythme baisse. Les horaires officiels des banques ne changent pas, puisque la rupture du jeûne est à 18h.
Parfois certaines usines et entreprises changent leurs horaires de travail où l’on commence à 8h30 et on finit à 14h30 au lieu de 15h. Mais en général, les Egyptiens travaillent moins. En Tunisue, le volume horaire moyen est de 5 heures (8h30-15h du lundi au jeudi et 8h-12h le vendredi). Pour Kamel Bouguessa, «la formule tunisienne est moins hypocrite car elle donne le temps aux travailleurs pour profiter de leur après-midi et pour ne pas aller faire les courses pour ensuite les stocker dans les bureaux».
Raison
Un avis pas très partagé par Kacemi : «Chaque pays a ses raisons dans ses législations. Quand on n’est pas productif, le nombre d’heures travaillées ne changerien. Dans beaucoup de pays, l’employé a une tâche à accomplir et il est surveillé». C’est une question de «discipline», argumente Kacemi. «Chaque Ramadhan tout revient : paresse, absentéisme...
Pour mieux s’organiser, les employeurs doivent revoir la planification du travail durant ce mois, car déjà sur le plan religieux c’est un mois de productivité». Il défend l’idée qu’il «ne faut pas que le Ramadhan soit un handicap, il faut que le travail soit optimisé, il doit répondre à ses des dimensions, familiale, économique et religieuse.
Pour M. Bouguessa, l’idéal pendant ce mois pour un bon fonctionnement du travail serait d’abord d’«organiser, faire participer les employés dans les services publics avec leurs propositions. Dans la plupart des domaines, on ne voit pas de personnel de qualité et de compétences.
Il faut prendre en considération aussi le nombre d’employés». Comment changer les comportements mais aussi assurer une bonne productivité ? «Il faut une grande volonté politique. Car l’employé devient alors le maître du logis et ce qui laisse place parfois au laisser-aller, à l’insouciance et à l’irresponsabilité», selon M. Bougessa.
Yamina Baïr
Raffinerie d’Augusta Les fausses notes d’un rachat
le 18.05.18 | 12h00

La semaine dernière, la compagnie nationale Sonatrach a opéré au rachat de la raffinerie italienne d’Augusta, en Sicile, auprès d’Esso Italiana. Depuis, la transaction fait beaucoup de bruit et suscite la polémique. Si certains sont pour et y voient une bonne affaire pour l’Algérie, d’autres ne sont pas du même avis.
Lundi, lors de la journée d’étude tenue au Sénat, la compagnie nationale des hydrocarbures a tenté de défendre la transaction et de calmer les suspicions autour du rachat de la raffinerie d’Augusta. L’Algérie a-t-elle fait une bonne affaire ? Pourquoi la compagnie américaine a-t-elle vendu cette raffinerie si elle est rentable ? N’aurait-il pas été plus judicieux pour l’Algérie d’investir dans la construction de nouvelles raffineries dans le pays ?
Entre son prix d’achat, le coût de sa rénovation, sa fonctionnalité et les modalités de paiement du personnel, l’acquisition de la première raffinerie extérieure suscite la préoccupation et les interrogations. Et si ce rachat est «l’affaire du siècle» pour les représentants de Sonatrach, ce n’est pas une si bonne affaire pour les experts financiers et économistes.
Pour d’autres, ce n’est pas aussi simple de définir la bonne ou la mauvaise affaire. En effet, selon l’expert financier Souhil Meddah, la lecture d’un tel contrat d’acquisition doit se faire sur une approche micro-économique en tenant compte des opportunités d’affaires, des coûts et frais d’engagement, des retombées et des retours sur investissement et des impacts économiques directs et indirects souhaités.
Dans ce cadre, chaque plan d’investissement a ses propres paramètres et son propre écosystème local ou extérieur dans lequel il évolue. Dans le cas Augusta/Sonatrach, Souhil Meddah explique la démarche de la compagnie nationale par le facteur de la proximité du lieu de l’investissement et de son raccordement en amont ou en aval avec les structures d’expédition ou de réception au niveau national.
«Ajouter à cela le fait qu’il s’agit d’un investissement dans lequel nous restons partie prenante que ce soit sur le plan de l’exploitation-vente ou de la consommation-achat par rapport à un marché algérien importateur et consommateur des principaux produits commercialisés ou ceux du domaine du dérivé», ajoute-il. Pour sa part, l’expert économiste Ferhat Aït Ali reste sur l’hypothèse négative et avance : «C’est une mauvaise affaire dans tous ses aspects, elle ne répond à aucun besoin de ceux présentés comme étant en passe d’être remplis par cette acquisition.»
Un investissement «illogique»
Selon Ferhat Aït Ali, la transaction Esso Italiana-Sonatrach ne répond à aucune logique de motivation de l’investissement. Pour lui, afin d’avoir un raisonnement méthodique dans le jugement d’un dossier, il faut commencer par identifier ce qui pousse un investisseur quelconque à aller s’impliquer quelque part, et ce, dans tous les domaines possibles et imaginables.
Et il se trouve que quand on achète un actif quelque part, cela obéit à plusieurs impératifs et motivations tels que ; la disponibilité d’un marché local porteur pour le produit à fabriquer ou à transformer localement, même si l’on est détenteur de la matière première ou d’un quelconque savoir-faire ; la disponibilité d’une ressource à exploiter sur place pour éviter de l’acheminer loin de son site d’origine pour l’exploiter ; la présence d’une opportunité d’affaire représentée par l’actif acquis à un prix comparé à son prix réel ; la présence d’un savoir-faire ou de brevets disponibles dans le pack acquis et qu’on n’a pas chez soi ; la présence d’avantages comparatifs en matière de coûts de production, de législation sociale ou de facilités fiscales.
«Or l’acquisition algérienne n’obéit à aucune logique à la lumière de ces critères ! Bien au contraire», assure-t-il.
Et d’ajouter : «Le marché européen ne nous intéresse pas dans la mesure où il est question de rapatrier le produit fini vers l’Algérie. D’ailleurs ce marché est le plus pourri et le moins porteur en matière de produits pétroliers. La ressource de base est chez nous et non en Europe, ce qui écarte l’attrait pour la ressource naturelle, l’équipement et le savoir-faire ciblé existent chez nous et peuvent être réalisés et opérés ici en investissant sur place. Et l’infrastructure en question date de Mathusalem et est en mauvais état à première vue.»
«650 salaires en Italie équivalent à 4000 salaires en Algérie»
Par ailleurs, pour Ferhat Aït Ali, le prix du rachat — qui a frôlé le million de dollars — est une preuve que l’Algérie est loin de faire une bonne affaire. Au contraire, «le prix de vente de la raffinerie est une preuve qu’on insistant un peu, les Américains auraient lâché cette bombe pour rien. Et ce n’est pas un hasard si les autres parties contactées par ExxonMobil n’ont pas saisi cette opportunité», lance-t-il.
Si, selon l’analyse de l’expert, la transaction ne présente aucun avantage, c’est aussi parce que la raffinerie va employer le même nombre de salariés que depuis son entrée en service, mais sera aussi soumise au règlement italien et aux normes salariales du pays.
Il poursuit : «Quant aux avantages comparatifs que présente l’Italie en terme d’investissements, surtout dans un domaine aussi polluant et sujet à incidents, il est tout simplement rébarbatif, avec des édiles pointilleux en matière d’environnement, des syndicats puissants et peu coopératifs, ainsi que 650 salaires faisant l’équivalent de 4000 salaires en Algérie.
Et, cerise sur le gâteau, les frais de transport du pétrole au départ et de rapatriement des produits en aval réglés dans les deux sens par l’Algérie.» En effet, selon les déclarations du P-DG de Sonatrach, Ould Kaddour, vendredi dernier, l’entreprise, qui emploie plus de 600 personnes, maintiendra le même effectif avec l’insertion d’un certain nombre d’employés de la compagnie nationale. Sur cette question, Ferhat Aït Ali n’exclut pas la possibilité que la raffinerie ne pourra pas faire de bénéfices et que les premiers salaires pourraient êtres livrés d’Alger.
«Du fait que de la manière dont nous gérons nos affaires en général, et vu celle avec laquelle celle-ci a démarré, il y a des chances que les salaires soient payés d’Alger sans qu’aucun baril ne soit raffiné avant longtemps, si les réserves du parquet de Syracuse sur lesquelles ExxonMobil s’était engagé à la réouverture du site, en septembre 2017, ne sont pas levées dans les délais imposés par la justice italienne et qui se terminent le 17 septembre prochain», poursuit-il. Soulignant que sur une base moyenne de 3000 euros charges sociales incluses, pour 650 employés, il est question de 23 millions d’euros soit 28 millions de dollars annuels à payer au titre des charges salariales.
«Le bénéfice ? un miracle ! »
«Et pour raffiner 64 millions de barils avec une marge de l’ordre de 5 dollars par baril, ce n’est pas gagné, cela ne fait que 300 millions de dollars de marge brute, de laquelle il faudra déduire les autres frais fixes et les frais variables. Si ça marche et que nous arrivons à tirer quelque 70 millions de dollars de cette acquisition par année, c’est un miracle», ajoute Ferhat Aït Ali. Tout en mettant l’accent que sur les frais d’opération qui nécessitera selon l’expert, environ 600 navires de 200 000 barils en rotation quasi quotidienne, qui reviennent chacun sur cette distance à environ 0,5 dollar le baril.
«En comptant un aller-retour à deux dollars le baril, il faudra compter dans les 120 millions de dollars de transport.» Pour l’économiste, l’Algérie ne pourra rentrer dans le bénéfice de ce rachat qu’après dix ans de service : «Sans incident notable, si le prix d’acquisition est bien celui déclaré et qu’aucune maintenance n’est inscrite à la charge de cette usine dans l’immédiat, au cours actuel du pétrole, il faudra attendre 10 ans pour amortir l’investissement initial.»
Tout en soulignant que dans dix ans, la raffinerie d’Augusta aura 80 ans — et il est douteux qu’avec cet âge et sans frais de rénovation lourd, elle reste encore en état de produire sans danger. «Sans oublier que dans dix ans, nos réserves actuelles ne pourront pas en même temps affronter l’exportation de brut et la consommation locale, qu’elle soit raffinée ici ou ailleurs. A partir de là, les critères universels de la bonne affaire ont changé depuis cette semaine, ou c’est l’archétype de la très mauvaise affaire, du moins pour l’Algérie», conclut-il.
Ryma Maria Benyakoub
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
Canal Algérie | Journal télévisé de 19 h pour Jeudi 17 Mai 2018

FRANCE 24 en Direct – Info et actualités internationales en continu 24h/24

FRANCE 24 English – International Breaking News & Top stories - 24/7 stream


فرانس 24 البث المباشر – الأخبار الدولية على مدار الساعة